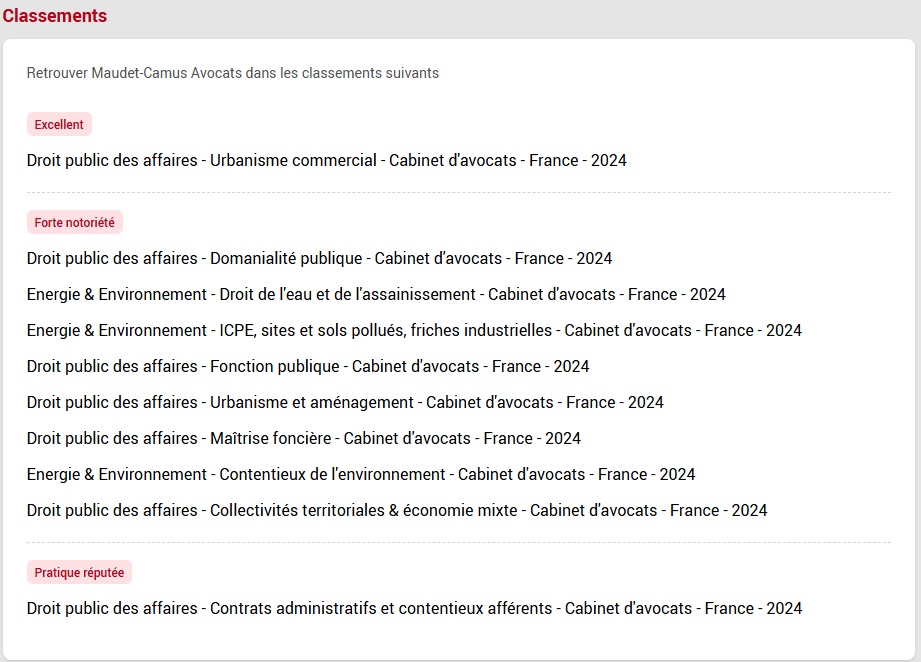Outre la réparation pécuniaire du préjudice, les tiers peuvent demander au juge d’enjoindre à la personne publique ou à son concessionnaire de déplacer l’ouvrage ou de procéder aux mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux nuisances.
L’article L.911-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.
La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’Etat était venu préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut faire usage de son pouvoir d’injonction pour ordonner le déplacement d’un ouvrage ou la mise en œuvre de mesures destinées à mettre fin au préjudice subi par les tiers. (Conseil d’État, 18/03/2019, 411462, Mentionné dans les tables du recueil Lebon)
Par un arrêt du 30 janvier 2024, la Cour Administrative d’appel est venue confirmer qu’un ouvrage même mal implanté n’a pas à être déplacé si ce déplacement présente une atteinte excessive à l’intérêt général.
En l’espèce, il s’agissait d’un transformateur appartenant à la société Enedis :
« 4. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l’écoulement du temps, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la résiliation par la société Nini du contrat de bail du 27 août 1964, le tribunal judiciaire de Nanterre a, par un jugement du 4 janvier 2021 devenu définitif, déclaré la société Enedis occupante sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2017 du local de 12m² au sein duquel est implanté un poste de transformation électrique. D’autre part, si la société Enedis, en tant que concessionnaire de distribution de l’énergie électrique, a le pouvoir, en vertu de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, de prendre l’initiative d’une procédure d’expropriation, il n’apparaît pas qu’elle ait effectivement envisagé d’y recourir. Il s’ensuit que le maintien du poste de transformation électrique au sein de l’immeuble du 99 avenue Achille Peretti constitue une emprise irrégulière sans que la régularisation de cette implantation irrégulière n’apparaisse envisageable en l’espèce.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le transformateur en litige, qui fait partie du réseau électrique de Neuilly-sur-Seine, dont il n’est pas contesté par la société requérante qu’il est entièrement souterrain, est pleinement exploité et assure la desserte en électricité de 225 foyers et 59 locaux professionnels. Il résulte également de l’instruction que la suppression du poste de distribution » Peretti » en litige ne peut être compensée par la création d’un nouveau poste compte tenu de l’absence d’opportunité foncière publique, liée notamment à l’encombrement du sous-sol de la voirie par les réseaux de transport, ou d’opportunité foncière privée, à défaut de projet de nouvelle construction dans ce secteur. Sa suppression nécessiterait ainsi de basculer la puissance qu’il génère vers des postes de distribution voisins. Or les règles de l’art en matière de distribution de proximité, telles qu’elles résultent des prescriptions du réseau de distribution d’électricité » Développement du réseau basse tension « , requièrent de raccorder une installation au poste de distribution le plus proche géographiquement, afin de minimiser les effets de chute de tension pour les usagers, ainsi qu’au cas d’espèce, les risques d’incidents. L’étude du 14 juin 2021 produite par Enedis, qui prend également en compte la configuration urbaine, identifie ainsi trois postes de distribution voisins susceptibles d’absorber la puissance qui résulterait de la suppression du poste de distribution en cause, à savoir les postes » Saint Pierre 18 « , » Louis Philippe 9 « , » Orléans 9 « . Elle conclut toutefois, sans être utilement contestée par la société requérante, qu’il n’est pas possible de basculer la puissance vers les postes proches » Louis Philippe 9 » et » Orléans 9 » sans dépasser les limites techniques d’intensité de ces postes, ni vers le poste » Saint Pierre 18 » en raison de l’impossibilité technique de créer de nouveaux départs depuis ce dernier. En outre, un tel basculement de puissance aurait pour conséquence une saturation des postes » Louis Philippe 9 » et » Orléans 9 « , ce qui empêcherait de répondre à d’éventuels besoins complémentaires en électricité à proximité. De surcroît, le fait que les postes seraient amenés en limite de capacité, à échéance de moins de dix ans, empêche de mobiliser ces postes existants pour faire face à un incident d’exploitation. Enfin, la société requérante se borne à alléguer qu’il n’est pas établi que d’autres postes voisins ne pourraient pas absorber la puissance correspondant au transformateur en litige, sans préciser les postes qui pourraient faire l’objet d’un redéploiement sans franchissement souterrain de voie.
7. D’autre part, le poste de transformation électrique en litige occupe un local d’environ 12m² situé au sous-sol de l’immeuble appartenant à la société Nini. Si cette société soutient que cette présence, de même que l’opposition d’Enedis à la fermeture du porche qui surplombe ce local dès lors que la trappe d’accès située au droit du local ne serait plus accessible directement et en permanence et n’assurerait plus la ventilation, elle n’établit pas qu’un projet de réaffectation à usage d’activités du reste de l’emprise du sous-sol et du porche serait impossible et la priverait de la possibilité de réhabiliter son bien. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’implantation actuelle de l’ouvrage engendre des risques de sécurité particulier pour les occupants de l’immeuble, ni compte tenu de la configuration des lieux et de ce que l’accès au local est verrouillé, que les intrusions répétées dans le sous-sol seraient dues à la société Enedis. De plus, la société requérante ne justifie pas de l’existence des troubles sonores pour les occupants causés par l’ouvrage situé au sous-sol de l’immeuble. Ainsi, s’il est constant que le maintien de l’ouvrage empêche la réutilisation par la société requérante de 12m² de surface de sous-sol et celle d’une même superficie au-dessus de ce local, au niveau du porche, en raison de la présence d’une trappe qui doit demeurer directement accessible de façon permanente, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts privés en présence présentent néanmoins un caractère limité.
8. Au regard des inconvénients limités que la présence de l’ouvrage entraîne pour la société requérante, de l’absence de perspectives de relocalisation, et des conséquences qui résulteraient de la démolition du transformateur pour le service public de distribution d’électricité, il résulte de l’instruction que son déplacement entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général. Pour les mêmes motifs, un tel maintien n’est pas contraire à l’article 1er du protocole I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision refusant de faire droit au déplacement de l’ouvrage doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction avec astreinte doivent également être rejetées. » (CAA VERSAILLES, 30 janvier 2024, N° 21VE03143)
Au plan indemnitaire, le juge tient classiquement compte des indemnités déjà versées.
« Sur les conclusions indemnitaires :
9. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. Si la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle. Par suite, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
10. La société Enedis doit, conformément au point 7 du présent arrêt, réparer intégralement le préjudice direct et certain découlant de son occupation irrégulière de la propriété de la société Nini. Il ne résulte pas de l’instruction que la société subisse une privation définitive de la jouissance de ce bien, ni de sa qualité de propriétaire. Compte tenu de la nature et de l’état des locaux, situés en sous-sol, la valeur locative annuelle n’a, ni à être fixée par référence aux loyers de locaux d’activité à 1 000 euros/m² par an, ni par référence aux dispositions de l’article R. 332-16 du code de l’urbanisme à la somme de 106,71 euros/m². Il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du préjudice temporaire de jouissance subi par la société, compte tenu de la surface d’emprise du local de 12m² en sous-sol et des conséquences liées à la nécessité de maintenir une trappe directement et en permanence accessible au-dessus de ce local, au niveau du porche, en fixant l’indemnité d’occupation à la somme de 400 euros/m² soit 4 800 euros par année d’occupation irrégulière à compter de la réclamation préalable du 24 septembre 2018.
11. Toutefois, par un jugement du 4 janvier 2021, devenu définitif en l’absence d’appel, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la société Enedis occupante sans droit ni titre du local en litige après résiliation du bail par la SCI Nini et a condamné la société Enedis à verser à la SCI Nini une indemnité annuelle d’occupation de 3 000 euros par an. Eu égard à la finalité de cette indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer l’entier préjudice subi par le bailleur en contrepartie de l’occupation des lieux mais aussi en réparation de la privation de son bien, le juge administratif est tenu de prendre en compte cette condamnation qui a permis à la société requérante d’obtenir ainsi partiellement réparation de son préjudice indemnisable sur le même fondement que celui retenu dans le cadre du présent arrêt au point 10, pour la détermination du montant de la somme due par la société Enedis au titre des dommages et intérêts.
12. Il en résulte que la société Enedis doit donc être condamnée à verser à la société Nini une somme de 9 400 euros pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et la date du présent arrêt, puis la somme supplémentaire de 1 800 euros par an jusqu’à la libération totale des lieux occupés par le transformateur litigieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nini est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 mars 2021 attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions indemnitaires du fait du maintien irrégulier du transformateur électrique et à obtenir la somme de 9 400 euros au titre de son préjudice subi au cours de la période comprise entre le 24 septembre 2018 et la date du présent arrêt, majorée d’une somme supplémentaire de 1 800 euros par an jusqu’à la libération du local occupé par ce transformateur. » (CAA VERSAILLES, 30 janvier 2024, N° 21VE03143)
Jérôme MAUDET
Avocat Associé