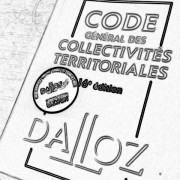La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN, a modifié les conditions d’exercice du droit de visite en matière d’urbanisme.
Cette réforme a été motivée par le renforcement de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale.
Postérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme, par un arrêt du 16 mai 2019 n° 66554/14 la Cour européenne des droits de l’Homme a d’ailleurs jugé que les visites domiciliaires telles que prévues antérieurement en matière d’urbanisme méconnaissaient l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN deux hypothèses se distinguent :
- Le droit de visite et de communication dans un contexte d’autorisation d’urbanisme délivrée régulièrement (articles L.461-1 et suivants du Code de l’urbanisme)
- Le droit de visite de constructions en cas de méconnaissance des règles d’urbanisme (articles L.480-17 et suivant du même Code)
I. L’exercice du droit de visite et de communication
Dans sa nouvelle rédaction l’article L.461-1 du Code de l’urbanisme dispose que :
« Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. »
L’article L.461-2 du même Code précise que :
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment. »
Ce droit de visite peut s’exercer jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux.
S’il est établi qu’une construction a été édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme l’autorité compétente peut mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable.
En cas de refus d’accès par l’occupant du domicile ou si la personne ayant qualité pour autoriser l’accès n’est pas joignable, les visites doivent être autorisées par le juge des libertés et de la détention
L’article L. 461-3 précise que :
« l’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter ».
Si l’occupant ou son représentant est absent, l’ordonnance doit alors être notifiée à l’intéressé après la visite par courrier recommandé avec accusé de réception.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par voie d’huissier.
En l’absence de l’occupant, les agents chargés de la visite ne pourront procéder aux constats qu’en présence de deux témoins qui ne doivent pas être placés sous leur autorité.
Le juge des libertés et de la détention a la possibilité de se rendre sur place pendant la visite qui s’effectue sous son contrôle et son autorité.
En application de l’article L.461-3 le procès-verbal doit être dressé « sur-le-champ ». Il devra donc être rédigé de manière manuscrite et relater les modalités et le déroulement de la visite.
Les agents y consignent leurs constatations.
Ce procès-verbal est signé par les personnes présentes.
L’original du procès-verbal mentionnant les délais et voies de recours doit être adressé au juge de la liberté et de la détention et une copie est remise ou adressée par courrier recommandé à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
II. Le droit de visite applicable aux infractions au code de l’urbanisme
L’article L.480-1 du code de l’urbanisme dispose que :
« Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. »
Dans cette hypothèse, le constat d’infraction n’a pas obligatoirement à être rédigé sur place et une copie du procès-verbal devra être transmise dans un délai de cinq jours au ministère public.
L’article 29 du Code de procédure pénale dispose en effet que :
« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.»
Le non-respect de ces délais de 3 jours est toutefois apprécié avec bienveillance par le juge judiciaire en application de l’adage « pas de nullité sans grief » :
« Attendu que, pour rejeter l’exception tirée de la nullité du procès-verbal de constat du 13 septembre 2007, l’arrêt retient notamment que la nullité prévue par l’article 29 du code de procédure pénale, qui n’est pas une nullité d’ordre public, ni une nullité résultant de la violation des droits de la défense, ne fait pas grief aux prévenus dès lors qu’ils ne sont pas directement lésés, ni même concernés par cette irrégularité relative au délai de transmission de la procédure au procureur de la République, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué par les appelants que l’inobservation de ce délai ait porté atteinte à leurs intérêts ; » (Cass. Crim. 7 décembre 2010. N° de pourvoi: 10-81729)
La Loi ELAN a créé l’article L.480-17 du code de l’urbanisme pour encadrer les constatations et le droit de visite des agents :
« I.- Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
II.- Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 6 heures et 21 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. »
Cet article permet un droit de visite dans la perspective de dresser procès-verbal de constat d’infraction.
Concernant les établissements et locaux professionnels, ces agents sont dans l’obligation d’en informer le Procureur de la République, qui peut s’opposer à cette visite.
Ce droit de visite ne peut s’exercer qu’aux heures ouvrées sauf si les locaux sont ouverts au public.
Concernant les domiciles et locaux comprenant des parties à usage d’habitation, les visites ne peuvent se dérouler que de 6 heures à 21 heures, et avec l’assentiment de l’occupant.
En cas de refus, cette visite ne pourra s’effectuer qu’en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction.
En cas d’obstacle à ces deux droits de visite, l’article L.480-12 prévoit que :
« Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Jérôme MAUDET
Avocat