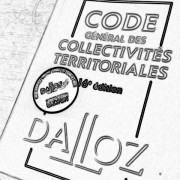Aménagement commercial : Brèves de jurisprudence
Permis de construire- dualité des moyens- surface de vente- doute – inopérante des moyens tirés du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale
La CAA de Marseille juge que les moyens dirigés contre une autorisation d’urbanisme qui n’a pas été soumise à l’examen pour avis de la CDAC fondés sur la méconnaissance du code de commerce sont inopérants, nonobstant les doutes qui ressortiraient de l’analyse des pièces du dossier quant à la surface de vente effectivement réalisée. (CAA Marseille, 5 mars 2020, n° 19MA03044)
Aménagement commercial – Une commune d’implantation est-elle recevable à solliciter du juge administratif l’annulation d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sur le fondement duquel elle avait dû refuser la délivrance d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ? (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et le décret n°2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial, le contentieux de l’urbanisme commercial ne cesse de soulever des interrogations entre l’articulation des anciennes et nouvelles règles en matière de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales et, comme l’illustre ce récent arrêt, du caractère faisant grief des avis rendus par les commissions d’aménagement commercial.
En l’espèce, et après un premier avis défavorable de la CNAC en novembre 2018, une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale avait été sollicitée par le porteur du projet sur le territoire de la commune de Guignen pour la création d’un supermarché et d’un drive. Le projet, remanié après le refus essuyé, avait reçu l’avis favorable de la CDAC d’Ile et Vilaine en janvier 2019.
Plusieurs exploitants concurrents ont formé devant la CNAC un recours à l’encontre de cet avis favorable, laquelle a émis le 4 avril 2019 un avis défavorable, contraignant ainsi le maire de la commune à refuser la délivrance du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Saisissant la cour administrative d’appel de Nantes, la commune d’implantation sollicitait l’annulation de l’avis défavorable de la CNAC.
Se posait néanmoins la question de la recevabilité de cette contestation car au regard de positions récentes du Conseil d’Etat et notamment de l’avis contentieux « Difradis » du 15 avril 2019 (2) ainsi que de la décision Société SODIPAZ du 27 janvier 2020 (3), l’acte par lequel la CNAC se prononce sur le projet d’équipement commercial a, après la mise en vigueur fixée au 15 février 2015 des dispositions de l’article 6 du décret du 12 février 2015, le caractère d’une simple mesure préparatoire et non d’un acte décisoire susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour autant et relativement à des communes en compétence liée de refuser la délivrance du permis de construire valant AEC lorsqu’un avis défavorable des commissions d’aménagement commercial est ainsi rendu, les juges du fond font montre d’une jurisprudence plus pragmatique des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme.
Poursuivant sa jurisprudence en la matière, la Cour administrative d’appel de NANTES a, en l’espèce, jugé :
« En vertu des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme (…) en vertu des dispositions de l’article L. 752‑1 du code de commerce (…)». De l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Il résulte de ces dispositions et en particulier de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, que lorsque l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial est défavorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivré. Le maire étant ainsi tenu de refuser le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, il est de ce fait recevable, le cas échéant, à solliciter directement devant le juge l’annulation de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial » (CAA Nantes, 28 février 2020, n°19NT02099 Commune de GUIGNEN (1)
Et confirme ainsi la lecture faite des dispositions combinées des articles L425-4 du Code de l’urbanisme et des articles L 752-1 et suivants du Code de commerce par cette même cour dans un arrêt du 15 septembre 2017 :
« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.(…)/ A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. » ; qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I.-Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable (…)» ; qu’il résulte de ces dispositions que lorsque l’avis de la commission nationale d’aménagement commercial est favorable, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne peut être refusé sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-1 et suivants du code de commerce ; que dans ces conditions, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est recevable à solliciter devant le juge de l’excès de pouvoir l’annulation de l’avis rendu par la commission nationale d’aménagement commercial qui présente à son égard un caractère décisoire ; qu’il suit de là, que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la société L. doit être écartée ; » (4) ;
Il est à noter également que la cour administrative d’appel de Bordeaux a également pris position en ce sens dans un arrêt en date du 2 novembre 2017(5).
Ces dernières décisions n’ont pas été frappées de pourvoi. Toutefois, et au regard de la décision société SODIPAZ du Conseil d’Etat précitée, il pourrait en être différemment pour cet arrêt du 28 février 2020, dont la solution ne deviendra définitive qu’à l’échéance du délai de pourvoi.
Céline CAMUS- Avocate associée – Cabinet d’avocats Maudet-Camus
Gaëlle PAULIC – Avocate Cabinet d’avocats Maudet-Camus
- CAA Nantes, 28 février 2020, Commune de Guignen, n°19NT02099
- Conseil d’Etat, 15 avril 2019, Société DIFRADIS, n°425854
- Conseil d’Etat, 27 janvier 2020, Société SODIPAZ et autres, n°423529
- CAA Nantes, 15 septembre 2017, Commune de Loudéac et Communauté intercommunale pour le développement de la région et des agglomérations de Loudéac, n°16NT00526
- CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, Société EURO DEPOT IMMOBILIER, n°16BX03230