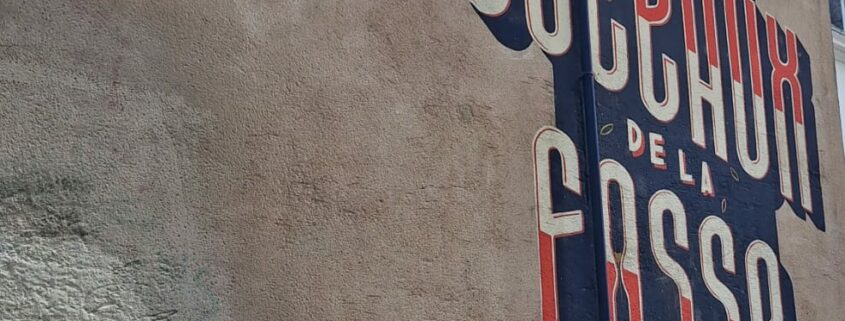Loyauté de la preuve en matière disciplinaire : le relevé d’activation de l’alarme n’est pas une preuve déloyale
Exerçant les fonctions d’agent d’entretien des bâtiments, une agente était chargée de désactiver l’alarme de l’hôtel de ville et de l’activer à son départ du service.
Pour constater que l’agente ne respectait pas les horaires qui lui étaient imposées, la commune employeuse a produit le relevé de l’activation et de la désactivation de l’alarme établi par la société de sécurité sans que la juridiction administrative ne considère ce procédé comme relevant d’une preuve déloyale.
En ce sens, le Tribunal administratif d’ORLEANS a jugé que :
« 10. En premier lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
11. En l’espèce, alors même que le digicode n’était pas destiné au pointage du personnel, la preuve ainsi constituée par la commune d’Avord n’a pas été obtenue en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle est tenue l’employeur et dont le principe est rappelé au point précédent. Il ne s’agit en effet nullement d’une preuve obtenue de manière déloyale. Aussi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit-il être écarté » (T.A. Orléans, 11 juin 2025, n°2202618).
Constatant à l’aide de ce moyen de preuve que le retard estimé sur une période de 8 mois atteignait les 158 heures, l’exclusion définitive des fonctions n’a pas été considérée comme disproportionnée.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
L’abrogation d’une décision octroyant le bénéfice d’une NBI est possible
1. Il est constant qu’aux termes des dispositions combinées des articles 1er du décret n°93-863 en date du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale, 1er et 2 du décret n°2006-779 en date du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, le bénéfice de la NBI est rattaché à l’exercice effectif des fonctions.
Dès lors que l’agent n’exerce plus les fonctions ouvrant droit au versement de la NBI, il y a lieu d’en supprimer le bénéfice.
Cependant, en l’absence de changement d’affectation de l’agent, l’administration est-elle tout de même en droit de supprimer le bénéfice de la NBI?
2. Considérée comme créatrice de droit, une décision portant octroi de la NBI bénéficie des règles applicables en cas de retrait ou d’abrogation d’une décision administrative.
Ainsi, une décision de retrait de la NBI à un agent plus de quatre mois après son édiction est illégale.
En ce sens, la Cour administrative d’appel de DOUAI a jugé que :
« 20. En second lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement. M. B soutient que l’arrêté n° 2020-184 du 20 octobre 2020 méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’il prend effet à une date antérieure à son édiction, soit à compter du 1er octobre 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’à raison de ses fonctions, lui a été attribuée, à compter du 1er juillet 2015, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points par un arrêté du 29 juin 2015. Or, s’agissant d’une décision créatrice de droit, la commune ne pouvait y mettre fin que pour l’avenir. A cet égard, la circonstance que M. B a été placé dans une situation conservatoire dans l’attente de l’avis de la commission de réforme est sans incidence. Par suite, en conférant une portée rétroactive à sa décision, le maire de la commune de Pont-de-Metz a entaché sa décision d’illégalité » (C.A.A. Douai, 5 mars 2025, n°23DA00109).
Cependant, l’hypothèse d’une abrogation pour l’avenir du bénéfice de la NBI fondée sur une modification de l’appréciation portée sur la situation de l’agent est envisageable.
3. En ce sens, reprenant la qualification d’acte créateur de droit et reprenant les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, le tribunal administratif de NANTES a jugé, à propos d’une demande d’annulation d’un arrêté supprimant pour l’avenir le bénéfice de la NBI, que :
« 1. M. A B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, exerçant les fonctions de chef du groupement sud, « bâtiments/infrastructures », s’est vu attribuer, par un arrêté du 17 mars 2010 à effet rétroactif au 1er mars 2010, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points au titre de ses fonctions d’encadrement d’un service administratif d’au moins vingt agents. Par un arrêté du 9 février 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique a abrogé l’arrêté du 17 mars 2010 à compter du 1er mars 2021, lui supprimant par conséquent le bénéfice de cette bonification. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2021. (…)
L’arrêté attaqué est motivé en droit par le visa des textes applicables, notamment du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. En outre, il précise que M. B, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, n’exerce pas les fonctions d’encadrement d’un service administratif comportant au moins vingt agents. Dès lors, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. En troisième lieu, pour supprimer à M. B à compter du 1er mars 2021 le bénéfice de la NBI qu’il percevait antérieurement, le SDIS de Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’encadre pas un service administratif comportant au moins vingt agents au sens du point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006 précité. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de la NBI au titre du point 11 de ce même tableau. (…)
En revanche, le caractère créateur de droits de l’attribution d’un avantage financier tel qu’un complément de rémunération ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l’avenir si l’intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l’administration modifie l’appréciation qui avait justifié son attribution. Il appartient à l’autorité compétente de cesser d’attribuer un avantage financier donnant lieu à des versements réguliers lorsque son maintien est subordonné à des conditions qui doivent être régulièrement vérifiées et qu’elle constate que celles-ci ne sont plus remplies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer une NBI à hauteur de 25 points à compter du 1er mars 2010, sur le fondement du décret du 3 juillet 2006 susvisé. L’octroi de cet avantage financier et sa répétition pendant onze ans révèlent, non pas une simple erreur de liquidation, mais une décision individuelle créatrice de droits prise en considération des fonctions exercées par l’intéressé. (…) le maintien du bénéfice de cette bonification de 25 points était toutefois subordonné à la condition que l’intéressé exerce effectivement les fonctions prévues par le point 10 du tableau annexé au décret du 3 juillet 2006. Aussi, en application des dispositions de l’article L. 242-2 du même code, l’administration pouvait, à bon droit, modifier l’appréciation alors portée sur la situation de l’intéressé et constater qu’il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l’octroi de la NBI et, ainsi, procéder à sa suppression pour l’avenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté » (T.A. NANTES, 18 juillet 2025, n°2203141).
En d’autres termes, dès lors que l’administration considère que les conditions d’octroi de la NBI ne sont plus réunies, et même en l’absence de changement d’affectation et de fonction, elle peut supprimer pour l’avenir le bénéfice de la NBI.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Le retrait du bénéfice de la NBI ne revêt pas, à lui seul, les traits d’une sanction déguisée
Il est constant qu’une décision portant atteinte à la situation de l’agent peut être qualifiée de sanction déguisée dès lors que sa situation professionnelle est dégradée et que l’intention poursuivie par l’administration révèle une volonté de sanction.
Cependant, le retrait de la nouvelle bonification indiciaire – conséquence de l’intervention d’une décision portant changement de mission dans l’intérêt du service – est insuffisante pour justifier l’existence d’une sanction déguisée.
Aux termes de son jugement en date du 31 juillet 2025, le tribunal administratif de NANTES rappelle que le bénéfice de cette bonification est attaché à l’exercice de fonctions y ouvrant droit. Dès lors que ces fonctions ne sont plus exercées, il n’existe aucun droit acquis pour l’agent à continuer d’en bénéficier et cette nouvelle bonification doit lui être retirée.
Il est ainsi jugé que « 6. En troisième et dernier lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
7. M. B soutient que la décision de cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire constitue une sanction déguisée. Toutefois, si cette mesure porte atteinte à sa situation professionnelle en le privant d’un élément constitutif de sa rémunération, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cessation du versement de la nouvelle bonification indiciaire découle de la fin de l’exercice des fonctions y ouvrant droit par M. B et de son changement de mission, lequel est intervenu dans l’intérêt du service » (T.A. NANTES, 31 juillet 2025, n°2205292).
Ainsi, le retrait du bénéfice de la NBI en raison du changement de mission, décidé dans l’intérêt du service, de l’agent ne revêt pas les traits d’une sanction déguisée quand bien même une décision de sanction interviendra ultérieurement à raison des mêmes faits à l’origine du changement de mission.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
CDIsation des agents publics : ceux recrutés pour répondre à une vacance temporaire peuvent y prétendre.
Les agents contractuels recrutés pour répondre à une besoin temporaire de l’administration ont le droit de prétendre à la conclusion d’un CDI passé le délai de six ans prévu à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique.
Aux termes de sa décision n°2025-1152 QPC en date du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel considère que la différence de traitement instituée entre les contrats conclus pour répondre à un besoin permanent de l’administration et ceux conclus sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique pour faire face à « une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » est sans rapport avec l’objet de la loi en date du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
S’appuyant sur les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de ce texte, le Conseil rappelle ainsi que par cette loi, « le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État« .
Il poursuit en indiquant qu’à cet égard « il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires« .
En conséquence, en introduisant une distinction entre les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent de l’administration et ceux recrutés pour répondre à une vacance temporaire, « les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont contraires à la Constitution » car méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé.
Le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics territoriaux en congé de maladie ordinaire est contraire à l’article L. 822-2 du code général de la fonction publique.
 Il vous reste 90 % de l’article à lire….
Il vous reste 90 % de l’article à lire….
Saisi d’un déféré préfectoral contre la délibération du 1er avril 2025 du conseil municipal de la commune de Castanet-Tolosan, le juge des référés près le tribunal administratif de TOULOUSE a décidé d’en suspendre l’exécution en ce qu’elle prévoit le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.
L’article 189 de la loi n°2025-127 en date du 14 février 2025 de finances pour 2025 a acté la modification de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique en ce que le fonctionnaire placé en congé de maladie perçoit pendant les trois premiers mois de son congé 90 % de son traitement.
En délibérant sur la possibilité d’offrir à ses agents le maintien d’un traitement plein sur les trois premiers mois du congé de maladie, la commune de Castanet-Tolosan a méconnu les dispositions de l’article 189 de la loi de finances précitée justifiant l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération entreprise.
En ce sens, il est jugé que « 5. Si l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d’organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité territoriale, elle ne peut néanmoins légalement, sans méconnaitre les dispositions citées au point 3, instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l’intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 189 de la loi du 14 février 2025, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité » (T.A. Toulouse, 15 juillet 2025, n° 2503735)
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Imputabilité au service d’un accident et état de santé antérieur de l’agent : de simples facteurs de risques sont insuffisants pour rejeter l’imputabilité
Saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de VERSAILLES (n°21VE03126), le Conseil d’Etat indique que l’imputabilité au service d’un accident tel un infarctus du myocarde ne peut être refusé au seul motif que l’état de santé antérieur de l’agent présentait des facteurs de risque et qu’aucun effort physique n’avait été réalisé au moment de l’évènement.
Il considère, dès lors que l’accident se produit sur les temps et lieux du service, qu’il appartient au juge administratif de rechercher si cet état de santé antérieur est la cause exclusive de l’acccident.
Plus précisément, il est jugé que « 5. Pour faire droit à l’appel du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la cour a jugé qu’un infarctus du myocarde survenu pendant l’exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s’il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l’exécution du service et qu’en l’espèce, un tel lien n’était pas établi dès lors que l’état de santé antérieur de Mme B… présentait des facteurs de risque et qu’elle n’avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l’évènement. En statuant ainsi, alors que l’accident s’est produit dans le temps et le lieu du service et qu’il lui appartenait par conséquent de rechercher si l’état de santé antérieur de l’intéressée était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent » (C.E., 18 juillet 2025, n°476311).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
La réaction véhémente d’un supérieur hiérarchique ouvre le droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il ressort de la jurisprudence établie en la matière que le bénéfice de la protection fonctionnelle « n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, [sauf] lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique » (Voir par exemple C.E., 29 juin 2020, n°423996).
Aussi, la réaction virulente d’un supérieur hiérarchique à la demande de précision d’une agente sur l’exécution d’une mission ne relevant habituellement pas de ses attributions ouvre le droit au bénéfice de cette protection.
Plus précisément, constatant que la demande de précision avait été formulée sur un ton courtois traduisant la volonté de l’agente d’accomplir au mieux sa tâche, le tribunal administratif de la MARTINIQUE a jugé que « le directeur du pôle Solidarités l’a alors interceptée le 8 décembre 2023, vers 8h30, et s’est vivement emporté, en criant contre [elle à] plusieurs reprises. Cette réaction véhémente et disproportionnée traduit de la part du supérieur hiérarchique (…) un comportement qui ne saurait être regardé comme susceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, et est ainsi de nature à justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle » (T.A. Martinique, 7 juillet 2025, n°2400622).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Bien fondé d’une demande de suspension devant le juge des référés : l’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation d’un requérant par une décision de sanction ne se présume pas et doit être démontrée.ne se pr
De manière parfaitement classique, et sans surprise, le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut ordonner la suspension d’une décision administrative à condition que l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Cette condition d’urgence s’apprécie au regard des conséquences de l’exécution de la décision en litige et ne justifiera une décision de suspension qu’à la condition que l’exécution de l’acte en litige « porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre« .
Cette atteinte ne se présume pas ; il appartient à l’agent public qui s’en prévaut à l’appui d’une contestation d’une décision de sanction ou de suspension des fonctions de la démontrer.
Rappelant le principe habituel, le juge des référés près le tribunal administratif de GUADELOUPE indique qu’il « appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue« .
La simple affirmation qu’une décision de sanction puisse avoir des effets sur la situation financière du requérant ou des répercussions psychologiques profondes est insuffisante pour justifier de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; encore faut-il le démontrer.
A défaut, la requête déposée s’expose à son rejet par ordonnance motivée et en dehors de toute audience conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative .
Le juge des référés près le tribunal administratif de GUADELOUPE retient en ce sens que « Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments tenant, tant à ses revenus et à ceux de son conjoint, qu’à ses charges personnelles et familiales permettant de considérer que l’intéressée se trouverait, de ce fait, placée dans une situation financière telle qu’en résulterait pour elle une situation d’urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs Mme A, en se bornant à affirmer l’existence de conséquences psychologiques et en produisant des pièces médicales établies le 6 mai 2025, le 16 mai 2025 et le 19 mai 2025, ne démontre pas suffisamment l’existence de telles difficultés en relation avec la décision attaquée. Si l’intéressée se prévaut également de ce que cette décision porte atteinte à sa carrière et à sa réputation, elle ne produit aucun élément de nature à établir que la mesure contestée aurait l’impact allégué et entraînerait des conséquences suffisamment graves et immédiates sur sa situation. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite » (T.A. GUADELOUPE, 10 juillet 2025, n°2500543).
Le choc émotionnel ressenti par un agent à l’issue d’un entretien disciplinaire n’est pas suffisant pour caractériser un accident de service.
La Cour administrative d’appel de Toulouse a jugé, ce 15 juillet 2025, que la circonstance qu’une agente ait ressenti à l’issue de son entretien individuel d’évaluation un choc émotionnel est insuffisante pour constituer un accident de service.
S’appuyant sur la jurisprudence applicable en la matière, le Cour rappelle qu’un entretien d’évaluation ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, sauf à ce qu’il ait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
A ce titre, formuler des recommandations, remarques et reproches – y compris sur le ton « d’un directeur mécontent de son agent » – n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ; peu importe les effets – forcément incommodants – qu’ils produisent sur l’agent.
En ce sens, il est jugé que « 5. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent » (C.A.A. TOULOUSE, 15 juillet 2025, n°23TL02306).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé
Malgré une perte de rémunération et une réduction des attributions de l’agent, un changement d’affectation n’est pas une sanction déguisée.
Dans son jugement en date du 24 juin 2025, le tribunal administratif de STRASBOURG rappelle utilement le sens de la jurisprudence applicable lorsqu’un changement d’affectation revêt, en réalité, les traits d’une sanction déguisée.
Ainsi, elle indique que :
« 4. Un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent » (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).
Aussi, deux conditions cumulatives sont exigées :
- une dégradation de la situation professionnelle de l’agent,
- une volonté de sanctionner l’agent.
En l’espèce, la Maire nouvellement élue de la commune de LONGEVILLE-LES-METZ avait décidé de procéder à une réorganisation du fonctionnement de la collectivité en affectant notamment la requérante, recrutée à l’origine pour exercer les fonctions de directrice générale des services, sur un poste comprenant notamment le suivi des marchés publics et l’encadrement de six agents.
Cette nouvelle organisation avait notamment pour ambition de mettre « fin aux tensions et difficultés qui avaient existé les mois précédents et qui avaient conduit, en partie, à la démission du précédent maire« .
Prenant en compte ces deux éléments, le tribunal administratif de STRASBOURG constate certes l’existence d’une perte de rémunération et de responsabilité de l’agente mais considère que compte-tenu des éléments portés à sa connaissance aucune velléité disciplinaire ne pouvait être constatée.
Il juge ainsi que :
« Si ce changement d’affectation emporte, certes, une perte de rémunération et une réduction des attributions de la requérante, il est constant qu’il n’affecte pas son traitement de base, qu’il ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut, et qu’il ne peut pas davantage faire craindre un ralentissement dans l’évolution de sa carrière. Par ailleurs, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que la commune aurait eu l’intention de la sanctionner. Dès lors, il n’est pas établi que l’autorité municipale aurait, en décidant du changement d’affectation de la requérante, poursuivi un autre but que l’intérêt du service et aurait pris une sanction déguisée« (TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2300616).
Me Louis-Marie Le Rouzic
Avocat associé