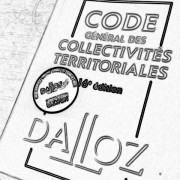Droit de la santé : motivation des sanctions prononcées par l’ARS
L’Agence Régionale de Santé dispose d’un pouvoir de sanction sur les établissements de santé.
A titre d’exemple l’article D.162-13 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de non-respect par l’établissement de santé des engagements souscrits au titre d’un exercice, constaté au vu du rapport transmis par l’établissement en application de l’article D. 162-10 et, le cas échéant, des résultats des contrôles sur pièces et sur place effectués, le taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 peut être réduit et fixé entre 70 % et 100 %. Il peut varier, le cas échéant, selon les spécialités pharmaceutiques ou les produits.
Le taux de remboursement qu’il est proposé d’appliquer pour un an est communiqué à l’établissement, avant le 15 mai, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. L’établissement transmet ses observations écrites, dans les mêmes formes, à l’agence régionale de santé dans les dix jours suivant cette réception. Le taux de remboursement est arrêté, chaque année, au plus tard le 15 juin, par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il est applicable pour la période du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante.
La fixation du taux de remboursement de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie doit être motivée. »
La sanction doit toutefois être proportionnée aux manquements constatés et être motivée en fait et en droit.
A défaut, la mesure sera classiquement considérée comme irrégulière.
En effet, selon une jurisprudence constante, le juge administratif censure les décisions insuffisamment motivées :
« 4. Considérant que la décision du 3 août 2010, par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a infligé une sanction d’un montant global de 773 108 euros au CHU d’Angers, se réfère au seul article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, sans viser les dispositions relatives aux règles procédurales et aux modalités de détermination du montant de la sanction ; que, si elle mentionne le courrier du 31 mars 2010 par lequel l’ARH des Pays de la Loire a notifié à l’établissement les résultats du contrôle de tarification effectué du 5 au 21 octobre 2009, qui comportait en annexe la liste des anomalies relevées et l’indication des modalités de calcul de la sanction maximale encourue dans chacun des champs contrôlés, ainsi que les observations produites le 20 avril 2010 par l’établissement et la proposition émise par la commission de contrôle dans sa réunion du 21 juillet 2010, la décision litigieuse, à laquelle n’était jointe aucune pièce et notamment pas la copie de l’avis de la commission de contrôle, ne donne aucune précision, notamment pour le champ » séjours avec complications ou morbidités associées « , pour lequel la proposition de sanction initiale s’élevait à la somme de 1 086 097 euros, sur la nature et l’importance des manquements retenus en définitive, sur la suite réservée aux observations de l’établissement, et sur les modalités de détermination du montant de la sanction prononcée, sensiblement réduit par rapport à la proposition préalablement notifiée ; qu’ainsi, elle ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la circonstance que l’établissement ait eu connaissance des manquements relevés et ait pu en discuter le bien-fondé au cours de la procédure contradictoire ne dispensait pas, en l’espèce, la directrice de l’agence régionale de santé de l’obligation d’indiquer, dans la décision contestée, les faits finalement retenus à l’issue de la procédure et justifiant la sanction infligée ainsi que les modalités précises de détermination du montant de celle-ci ; » (CAA NANTES, 2 juin 2015, N°13NT01772)
Voir également en ce sens :
« 3. Considérant qu’une sanction financière prononcée en application de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu’en l’espèce, la délibération n° 2009/279 du 9 décembre 2009, qui se borne à mentionner, après avoir visé, en particulier, le rapport de contrôle établi par l’unité de coordination régionale du contrôle externe faisant apparaître » des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l’article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale pour les GHS 8047, GHS 8298 « , ainsi que la notification du rapport de contrôle adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble par l’unité de coordination régionale du contrôle externe du 24 février 2009 et la notification de la sanction financière envisagée du 23 octobre 2009, que » les motifs justifiant les sanctions financières envisagées ne sont pas remis en cause « , n’indique pas la période du contrôle, ni celle des facturations, ni ne précise le détail et le nombre des manquements constatés lors du contrôle dans les GHS en cause ; que la motivation ne saurait être apportée par référence aux informations contenues dans la lettre du 23 octobre 2009 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, faisant état de la sanction envisagée et des motifs la justifiant, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse des motifs effectivement retenus par la commission exécutive, seule autorité compétente pour prononcer la sanction financière et alors que le détail des anomalies ne figure pas davantage dans cette lettre, qui se borne à mentionner le pourcentage global des surfacturations retenu dans chacun des GHS sans indiquer le nombre de manquements constatés et sur la base desquels ont été déterminés lesdits pourcentages ; que pour la même raison, les informations figurant dans la lettre de notification du 17 décembre 2009 du directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, à laquelle d’ailleurs la délibération de la commission exécutive du 9 décembre 2009 n’était pas jointe, ne sauraient suppléer l’insuffisance de motivation de cette délibération ; » (CAA LYON, 19 février 2015, n°13LY02375)
Jérôme MAUDET
Avocat