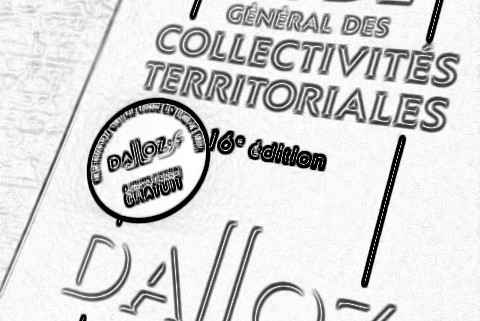Permis de construire : la fraude corrompt tout
Fraus omnia corrumpit.
Tout acte obtenu par fraude peut être retiré ou abrogé sans condition de délai (CE, 13 juin 2003, préfet Jura c/ Cattin N° 250503).
L’Administration est tenue de prononcer le retrait de sa décision :
« Le permis de construire litigieux a été obtenu à la suite de manoeuvres frauduleuses de son titulaire. Ainsi, il n’a pu créer de droits à son profit. Par suite, le maire saisi de la demande du requérant, même si celle-ci avait été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux à l’encontre dudit permis, était tenu d’en prononcer le retrait. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision implicite du maire refusant de retirer son arrêté du 8 août 1988. » (CAA Marseille, 1er juill. 1999, Morisson : JurisData n° 1999-111062).
L’appréciation de l’existence d’une fraude ayant conduit à l’obtention d’une décision relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge administratif entend assez largement la notion de fraude.
Il n’en demeure pas moins que la fraude doit être prouvée :
« En l’espèce, l’allocation pouvait être attribuée pour les 120 salariés d’un établissement licenciés pour motif économique et âgés de moins de cinquante-six ans et deux mois. Cette allocation été supprimée à un salarié algérien qui, pour obtenir du tribunal algérien de première instance la rectification de sa date de naissance uniquement dans le but d’obtenir le bénéfice de l’allocation litigieuse. Les radiographies effectuées révèlent que son âge se situe, sans certitude aux alentours de cinquante et un ou cinquante neuf ans, et vraisemblablement aux alentours de la soixantaine plutôt que de la cinquantaine. La fraude alléguée par l’administration n’est donc pas établie et ne pouvait justifier l’interruption du versement de l’allocation en cause. La décision du ministre rejetant le recours gracieux de l’intéressé est donc annulée. » (CAA Nantes, 29 juin 2001, Zoubairi : JurisData n°2001-175157)
Droit de propriété : peut on abandonner la mitoyenneté pour échapper aux travaux de réfection d’un mur ?
Aux termes de l’article 656 du Code civil :
» tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. »
De nombreux propriétaires de murs mitoyens en mauvais état ont imaginé pouvoir faire supporter les travaux de remise en état à leur voisin en lui abandonnant leurs droits.
« Trop facile » dit la jurisprudence.
Les juridictions judiciaires estiment en effet que le propriétaire d’un mur mitoyen ne peut pas se soustraire aux dépenses nécessitées par son fait en abandonnant à son voisin ses droits sur le mur :
« Le propriétaire d’une maison en ruine n’est pas fondé à solliciter l’application de l’article 656 du code civil, la faculté d’abandon de mitoyenneté prévue par ce texte ne pouvant être exercée par un copropriétaire lorsque les frais de remise en état sont rendus nécessaires par son défaut d’entretien comme c’est le cas en l’espèce. » (Cour d’appel de RENNES, 4 mai 1992, Numéro JurisData : 1992-046356)
Ou encore :
» Le seul tempérament à l’exercice de la faculté d’abandon de la mitoyenneté est qu’elle ne peut être exercée pour se soustraire aux dépenses d’entretien ou de réparation rendues nécessaires. » (CA Toulouse, 1re ch., sect. 1, 12 mai 1997 : JurisData n° 1997-043596).
Jérôme MAUDET
Avocat
Contrats publics : conséquences pécuniaires de la résiliation d’une délégation de service public
Par un arrêt du 4 mai 2015, le Conseil d’Etat est venu rappeler que le délégataire d’un service public qui voit son contrat résilié est fondé à demander l’indemnisation des biens de retour non amortis.
La circonstance qu’au terme de l’exploitation le délégataire n’aurait vraisembablement pas été en mesure d’amortir lesdits biens compte tenu du caractère assurément déficitaire de l’activité est inopérante :
« 2. Considérant, d’une part, qu’après avoir relevé que la commune avait mis fin à l’exécution de la convention du 12 janvier 2006 portant aménagement et exploitation des remontées mécaniques au motif tiré de ce qu’elle pouvait en constater la » caducité » dès lors que la société n’avait pas satisfait à l’exigence de justification d’une caution bancaire, la cour a jugé que la commune n’avait pas procédé à sa résiliation ; qu’en statuant ainsi, alors que la commune avait, ce faisant, mis fin à l’exécution du contrat pour un motif tiré du non respect de stipulations contractuelles par la société, la cour a dénaturé les clauses du contrat relatives à sa » caducité » ;
3. Considérant, d’autre part, que, pour refuser de faire droit à la demande d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour, la cour a également jugé que la société n’établissait pas qu’eu égard au caractère structurellement et lourdement déficitaire de l’exploitation de la remontée mécanique en l’absence de réalisation des autres équipements de la station, l’indemnisation de la valeur non amortie des biens qu’elle demandait excèderait la valeur actualisée des pertes d’exploitation qu’elle aurait dû subir de manière prévisible pendant toute la durée de la convention ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en cas de résiliation d’une délégation de service public avant son terme et quel qu’en soit le motif, le délégataire a droit à être indemnisé de la valeur non amortie des biens de retour, la circonstance que l’exploitation de la délégation aurait été déficitaire pendant la durée restant à courir de la convention étant à cet égard inopérante, la cour a commis une erreur de droit ; » (Conseil d’État, 7ème / 2ème SSR, 04/05/2015, 383208)
Rappelons au passage que les biens de retour sont ceux affectés à l’exploitation du service et indispensables à celle-ci. Ils reviennent obligatoirement à la collectivité délégante au terme du contrat.
Ils diffèrent donc des biens de reprise qui sont utiles mais non indispensables au fonctionnement du service public et demeurent la propriété du délégataire en fin de contrat.
Jérôme MAUDET
Avocat
Marchés publics : Comment s’apprécie la spécialisation de l’avocat ?
La refonte du régime des spécialisations des avocats a permis d’améliorer l’accès des avocats à une mention de spécialisation en remplaçant l’examen théorique prévu par un contrôle des connaissances portant sur la pratique professionnelle et d’autre part, de favoriser la lisibilité pour le public de compétences acquises au sein d’une liste renouvelée de mentions de spécialisation, arrêtée par le Conseil national des barreaux.
L’objectif de la réforme était de maintenir un niveau élevé d’exigence et d’instaurer une obligation de formation continue renforcée.
La mention de spécialisation est donc un gage pour le client que l’avocat est bien spécialiste de la matière concernée.
Dans le cadre des procédures d’appel à concurrence, les collectivités sont fondées à exiger des garanties quant à la compétence des candidats tout particulièrement en droit public.
Les règles de la commande publique exigent toutefois que les candidats soient mis sur un pied d’égalité.
Le titulaire d’une mention de spécialisation ne peut ainsi pas être favorisé si le réglement de la consultation n’impose pas que les candidats justifient de l’obtention de ce césame.
Par un arrêt confirmatif du 21 avril 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a censuré un marché public passé par une collectivité au motif que celle-ci avait évincé un candidat qui ne justifiait pas, par la production de certificats de spécialisation, sa « qualification d’avocat spécialisé en droit public ».
En substance, les juges ont considéré que dans la mesure où l’avis d’appel à concurrence prévoyait que les candidats pouvaient justifier par plusieurs moyens leur compétence en droit public, la collectivité ne pouvait pas écarter une offre au seul motif que le candidat n’était pas titulaire du certificat de spécialisation.
« 3. Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l’exigence d’égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l’article 1er de ce code ; que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du même code sont soumis aux dispositions de son article 1er, comme tous les contrats entrant dans le champ d’application de celui-ci ; que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que, dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu’il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ; que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu’il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l’article 28 du code des marchés publics, d’assurer l’information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n’implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures ;
4. Considérant que l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, d’une part, sous la rubrique » Autres renseignements demandés » » Qualification d’avocat spécialisé en droit public ou en droit de l’environnement français exigée « , tout en précisant que » Les candidats pourront justifier de leur compétence par tous moyens, y compris des références détaillées « , et d’autre part que les offres seraient évaluées sur le critère du prix, pondéré à hauteur de 55%, et sur celui de la valeur technique, à hauteur de 45% ; que l’article 5 du règlement de consultation prévoyait que la valeur technique serait analysée » au regard d’une note méthodologique détaillant : – la méthode de travail proposée (sur 2 points), – l’équipe dédiée au marché (sur 8 points) » ; qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur n’a attribué à la SELARL S. qu’une note de deux sur huit au sous-critère de l’équipe dédiée au marché en se fondant exclusivement sur la circonstance que les avocats affectés n’avaient pas justifié détenir le certificat de spécialisation délivré par l’ordre des avocats ; que l’appréciation de la valeur de l’équipe dédiée au marché ne pouvait se réduire à ce seul élément ; que les membres de l’équipe affectée par la SELARL S. justifiaient par ailleurs de leur compétence et spécialisation en la matière par leurs titres, leurs publications et leur expérience professionnelle ; qu’ainsi la communauté urbaine la communauté urbaine Le Mans métropole a donné à la détention de ce certificat de spécialisation une importance excessive et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’annulation du marché litigieux porterait une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité de l’irrégularité entachant la procédure de passation de ce marché, qui affecte le choix du cocontractant, la communauté urbaine Le Mans métropole n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le marché qu’elle a signé avec le cabinet X. et associés ; » (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/04/2015, 13NT01943)
Jérôme MAUDET
Avocat
Urbanisme : illégalité formelle, compétence liée ou pouvoir d’appréciation
Un décision administrative doit respecter un certain formalisme faute de quoi celle-ci est illégale.
A titre d’exemple, en application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 toute décision doit porter mention du nom et du prénom son auteur :
« Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
Ainsi, lorsque l’auteur de l’acte omet de mentionner ses nom et prénom la décision encourt l’annulation.
Encore faut-il qu’il existe une ambiguïté :
« 4. Considérant, au surplus, qu’aux termes de la loi du 12 avril 2000 susvisée : » (…) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ; que si la société » LC Appro » soutient que l’arrêté litigieux ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire d’Aubagne, il comporte sa qualité et sa signature ; qu’en l’espèce, il n’en résultait pour la société requérante aucune ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte ; » (CAA MARSEILLE, 7 Novembre 2014, N°13MA00761).
Par ailleurs, le moyen tiré de l’irrégularité formelle de l’acte attaqué est insusceptible de prospérer si l’auteur de l’acte se trouvait dans le cadre d’une compétence liée.
Le juge administratif considère en effet, que lorsque l’administration n’a d’autre choix que de prendre une décision dans un sens donné, il ne saurait lui être reprochée une quelconque illégalité formelle.
Encore faut-il que l’auteur de l’acte n’ait aucune marge d’appréciation.
C’est ce qu’est venue rappeler la Cour d’appel de Marseille dans un arrêt du 13 mars 2015 :
« 8. Considérant qu’il est constant que l’arrêté de refus de permis de construire du 14 avril 2011, qui doit être regardé comme portant retrait d’un permis de construire tacite, n’a pas été précédé de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire prescrite par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, laquelle a le caractère d’une garantie dont la société requérante a été effectivement privée ; que si le tribunal administratif de Montpellier a relevé que le maire était tenu de retirer le permis de construire illégalement délivré, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire était nécessairement conduit, pour relever l’éventuelle illégalité du permis en litige, à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, notamment sur la question de savoir si le projet d’extension était conforme aux exigences des dispositions du plan local d’urbanisme local applicables en zone agricole, où le projet est implanté ; qu’ainsi, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le maire n’était pas en situation de compétence liée pour retirer le permis tacite et le moyen d’irrégularité de la procédure n’est, par suite, pas inopérant ; » (Cour administrative d’appel MARSEILLE Chambre 9, 13 Mars 2015 , N°13MA02884).
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de Nantes
Expulsion : quels délais pour les squatters ?
Pour appréhender les délais d’expulsion de squatters ou d’occupants sans droit ni titre, plusieurs hypothèses doivent être envisagées.
Les délais de droit commun (trêve hivernale et délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux)
Confronté à une occupation illégale, le propriétaire qui souhaite reprendre possession de son bien doit engager une procédure en référé.
S’agissant des expulsions de logements illégalement occupés l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
Les procédures civiles d’exécution ont fait l’objet d’une codification à droit constant, de différents textes dont la loi n°91-960 du 9 juillet 1991 et le décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
Cette codification a été opérée par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution.
La partie réglementaire est issue pour sa part du Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution.
En pratique il s’est simplement agi de codifier les différents textes d’ores et déjà en vigueur sans modifier l’ordonnancement juridique.
Le juge d’instance, puis le juge de l’exécution, disposent d’un large pouvoir pour accorder des délais.
Pour le propriétaire, qui a intérêt à voir diminuer ou supprimer ces délais, il est capital de les anticiper dès le début de la procédure.
L’article L412-1 du Code des procédures d’exécution prévoit un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui peut être réduit ou supprimé par le juge :
‘Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.’
Les articles L.412-2 et suivants précisent les modalités d’expulsions et la faculté pour le juge et le juge de l’exécution d’accorder des délais aux occupants des immeubles à usage d’habitation ou professionnel.
L’article L412-2 permet au juge de proroger ce délai en cas de conséquence d’une exceptionnelle dureté pour les occupants:
‘Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.’
L’article L412-3 permet également au juge d’accorder des délais renouvelables si les occupants justifient de l’impossibilité pour eux de trouver un nouveau logement :
‘Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.’
L’article L412-4 précise que ces délais, ne peuvent excéder trois ans :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
L’article L412-5 précise toutefois que les délais sont suspendus si le Préfet n’a pas été informé au stade du commandement :
‘Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en informe le représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. A défaut, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.’
L’article L412-6 précise enfin que durant la période hivernale il doit être sursis à toute mesure d’expulsion sauf à ce qu’une voie de fait ait été démontré ou que l’immeuble soit l’objet d’un arrêté de péril imminent ou non imminent :
‘Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du premier alinéa ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.’
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que dès le début de la procédure et en particulier au stade du constat de l’occupation, le propriétaire victime d’une occupation illégale de son bien doit se constituer un certain nombre de preuves afin d’échapper à ces différents délais qui peuvent varier de 0 à plus de trois ans !
Le propriétaire devra s’attacher à démontrer une éventuelle flagrance mais surtout l’existence d’une voie de fait.
La flagrance
En cas d’infraction flagrante, les squatters peuvent être expulsés immédiatement.
En matière de squat d’immeubles bâtis, les forces de l’ordre considèrent, en principe, qu’avant l’expiration d’un délai de 48 heures, il est possible d’expulser les contrevenants dans la mesure où il s’agit d’un cas de flagrant délit de violation de domicile (serrure fracturée, carreaux cassés, volets arrachés…).
Passé le délai de 48 heures, il est nécessaire de saisir le juge compétent afin d’obtenir une décision de justice.
En droit, l’article 53 du Code de procédure pénale définit la flagrance et la procédure du même nom comme suit :
« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours. »
Le délai de 48 heures appliqué par les forces de l’ordre, et connu des squatters, relève en réalité plus d’une pratique et ne repose pas, à ma connaissance, directement sur une disposition législative ou réglementaire.
A ce stade de mes recherches, j’irai jusqu’à parler de légende urbaine enseignée dans les écoles de police.
Dans le cadre d’une proposition de loi n° 2480 du 13 juillet 2005, il avait d’ailleurs été proposé de porter à 72 heures le délai dans lequel la police peut intervenir pour constater le flagrant délit d’occupation illicite.
Selon les parlementaires auteurs de cette proposition, ce délai, « fixé par les textes à 48 heures », serait habituellement ramené à 28 heures par la jurisprudence.
Cette proposition est demeurée sans effet, ce qui est bien dommage pour les propriétaires d’immeubles squattés.
Il n’existe, à ma connaissance, aucun texte fixant le délai de flagrance à 48h.
En pratique, pour que les officiers de police judiciaire puissent agir en flagrant délit, il suffit qu’ils aient connaissance d’indices apparents d’un comportement délictueux qui vient d’être commis ou va l’être de façon imminente.
Le constat de flagrance permet de mettre en oeuvre les mesures listées aux articles 54 et suivants du Code de procédure pénale.
L’article 54 du Code de procédure dispose ainsi que :
« En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes. »
L’article 62-2 du même Code va jusqu’à légitimer la mise en garde à vue des personnes soupçonnées d’avoir commis un délit en état de flagrance :
« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
La flagrance est donc un constat de ce qu’un délit ou un crime vient d’être ou est en train d’être commis et permet la mise en oeuvre de mesures conservatoires, avant même qu’une juridiction ait été saisie et se soit prononcée.
L’existence d’une voie de fait
Si les occupants pénètrent dans les lieux au moyen de dégradations, ils ne pourront en principe prétendre au bénéfice d’aucun délai.
Les squatters, occupants sans droit ni titre par excellence, ne peuvent en principe pas prétendre au bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article 613-3 du Code de la construction et de l’habitation désormais codifié dans le Code des procédures civiles d’exécution à l’article L.412-6 :
» Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.’ Le juge des référés peut également supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution lequel dispose que : « Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait (…), réduire ou supprimer ce délai. »
Par un arrêt du 29 janvier 2013, la Cour d’Appel de Rennes a estimé que le simple fait d’occuper un immeuble d’habitation sans l’accord du propriétaire constitue une voie de fait :
« Considérant que non seulement l’occupation de l’immeuble sans l’accord du propriétaire mais également le refus opposé à son libre accès constituent une atteinte au droit de propriété ; qu’en tant que telle, ils caractérisent des voies de fait à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. » (CA Rennes, 29 janvier 2013, RG n°11/00872)
Tous les espoirs restent donc permis…
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Police du bruit : « La Cour de récréation » un cas d’école
« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » disait Saint François de Sales
Par un arrêt du 17 janvier 2013 la Cour administrative d’appel de Lyon est venue préciser l’étendue des pouvoirs de police du maire en matière de nuisances sonores liées à l’existence d’un équipement public.
En l’espèce, des riverains se plaignaient du bruit généré par les enfants dans la nouvelle cour de récréation située à proximité de leur habitation.
L’Expert venu mesurer les émergences sonores avait d’ailleurs révélé que la combinaison des voies stridentes des bambins évoluant dans la cour de récré dépassaient largement les seuils réglementaires.
Pour autant, la Cour a considéré que les pouvoirs de police du Maire s’arrêtaient aux portes de l’école.
Plus précisément, les juges d’appel ont souligné que les bruits sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution et ne sont pas au nombre de ceux que le Maire est tenu de réprimer.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’expertise acoustique à laquelle les requérants ont fait procéder en octobre 2010, que les bruits issus de la cour de récréation jouxtant nouvellement leur propriété, dépassent significativement le seuil d’émergence des bruits de voisinage fixé par les articles R. 1334-30 et suivants du code de la santé publique ; que, toutefois, les requérants ne contestent pas sérieusement que cette nouvelle cour n’accueille chaque jour que deux récréations d’une vingtaine de minutes et seulement en période scolaire ; que par ailleurs, l’expertise acoustique n’ayant été réalisée que pendant une de ces récréations, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les activités périscolaires et extrascolaires également invoquées généreraient à leur égard des nuisances supplémentaires ; qu’ainsi les bruits issus de la nouvelle cour de récréation de l’école maternelle, qui sont inhérents au fonctionnement d’une telle institution, n’apparaissent pas tels, notamment dans leur durée et leur répétition, que le maire de la commune ait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées ; » (CAA LYON, 17 janvier 2013, N° 12LY00984)
Dans la droite ligne de cette décision, la Cour administrative d’appel de NANCY avait déjà eu l’occasion de considérer que la responsabilité sans faute de la commune ne saurait être recherchée dans la mesure où les nuisances proviennent non pas de l’ouvrage public mais de l’utilisation qui en est faite.
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que lors de manifestations organisées dans la salle polyvalente Jacques Duclos à THIL, les bruits de musique, dont l’importance excessive du fait des volumes sonores justifiés aux heures nocturnes tardives est établie mais dont l’existence devait être connue des requérants au moment de l’acquisition de leur immeuble, n’ont pas pour origine la présence et le fonctionnement de l’ouvrage lui même mais l’utilisation qui en est faite ; que dès lors, la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ; » (CAA NANCY, 10 janvier 2005, N° 01NC01206).
Dans cet arrêt la Cour avait également pris soin d’écarter la responsabilité du maire pour carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police :
« Considérant, en second lieu, que les troubles générés par l’utilisation de la salle polyvalente sont de nature à porter atteinte à la tranquillité et au repos de M. Eric X et Mme Dolorès Y dont l’immeuble est mitoyen de la salle ; que, cependant, d’une part, informées de cette situation par leur plainte, les autorités communales ont fait procéder à d’importants travaux d’insonorisation de la salle ; que, d’autre part, la commune établit qu’au cours des années 1997, 1998 et 1999, ont eu lieu respectivement 17 manifestations dont 2 en nocturne avec musique, 29 manifestations dont 4 en nocturne avec musique et 23 manifestations dont 3 en nocturne avec musique, y incluses le bal du 14 juillet et la soirée du nouvel an ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que des désordres ont eu lieu sur la voie publique justifiant l’intervention de la police ; qu’ainsi, eu égard à la très faible utilisation nocturne de cette salle pour des manifestations sur fond de musique, au règlement strict qui régit l’utilisation de la salle communale tant dans l’espace que dans le temps, le maire doit être regardé comme n’ayant pas fait preuve de carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la faute ; »
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Droit des collectivités : responsabilité du maire à raison des nuisances causées par les occupants d’une aire d’accueil
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée à raison des nuisances subies par les riverains d’une aire d’accueil.
La prétendue carence des services de l’Etat n’est pas, à elle seule et à la supposée établie, de nature à exonérer la commune de sa propre responsabilité.
Par un arrêt du 5 novembre 2013, la Cour d’appel de BORDEAUX est venue rappeler ce principe qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence :
« 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2°Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage, (…)et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les pollutions de toute nature… » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 28 septembre 2009 à la demande de MmeA…, de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, rédigés tant en juillet 2009 qu’au cours de l’année 2012 et du premier semestre 2013, et de planches photographiques dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à l’aire d’accueil des gens du voyage aménagée provisoirement sur l’unité foncière située en face de l’habitation de M. B…et de MmeA…, que ladite aire est utilisée, par certains de ses occupants, comme lieu de dépôt de véhicules hors d’usage ; que des véhicules y ont été démontés et les pièces détachées entassées ; que de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, sont abandonnés sur l’aire d’accueil ; que les occupants du terrain y pratiquent des feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque, non seulement une nuisance olfactive pour le voisinage, mais une pollution atmosphérique ; que l’environnement de ce terrain est détérioré par de nombreux détritus et déjections, y compris des déjections humaines, qui affectent la salubrité des lieux ; qu’en outre, Mme A…a été conduite à porter plainte, le 2 mai 2012, en raison de blessures causées à un de ses animaux domestiques par un tir de fusil qu’elle impute à des occupants de ladite aire pour les avoir vus en possession d’une telle arme peu avant et peu après le coup de feu ; que si, pour contester les éléments de preuve ainsi produits par M. B…et MmeA…, la commune de Graulhet se prévaut d’un rapport établi par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn à la suite d’une visite des lieux le 24 juin 2009, ce document se borne à décrire les équipements disponibles pour attester de la conformité de l’aménagement aux dispositions réglementaires applicables et ne contredit pas sérieusement l’état des lieux dressé par le constat d’huissier et confirmé par les nombreux témoignages ; qu’il en est de même du rapport convenu des services de cette direction du 11 décembre 2009, à la suite d’une visite programmée et effectuée le 3 décembre 2009 avec un élu et des responsables de l’administration de la collectivité ; que, dans ces conditions, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’usage non conforme de l’aire d’accueil par ses occupants, au besoin par l’exclusion de l’aire, et aux atteintes portées à l’ordre public comme à la salubrité publique, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la situation, le maire de Graulhet a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que la police municipale relevant de la compétence du maire, à la seule exception de la tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée, par application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, la commune de Graulhet ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement, que les services de l’Etat ont pu commettre une faute en s’abstenant de poursuivre les responsables des troubles de voisinage que subissent M. B…et MmeA… ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’usage non conforme de l’aire d’accueil des gens du voyage, l’état d’insalubrité de l’environnement de cet équipement et les risques pour la sécurité de leurs animaux ont causé à M. B…et MmeA…, indépendamment des atteintes qui ont pu être portées à leur tranquillité par les occupants de l’aire, des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral dont ils sont en droit d’obtenir réparation ; que, si M. B…et Mme A…ont contesté devant la juridiction administrative plusieurs des actes relatifs à la création de l’aire d’accueil définitive sur le territoire de la commune de Graulhet, au demeurant sur un terrain à proximité immédiate de l’aire actuelle, cette circonstance ne permet pas de leur imputer les préjudices subis, contrairement à ce que soutient la collectivité ; que le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation excessive de l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre en la fixant à la somme de 15 000 euros ; » (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, N°13BX01069).
En cas de non respect des règles applicables à l’aire d’accueil et notamment du réglement intérieur la commune a tout intérêt à saisir le Tribunal administratif dans le cadre d’un référé mesure utile aux fins d’expulsion.
La procédure est relativement rapide puisqu’il convient de prévoir une quinzaine de jours pour obtenir une ordonnance.
Voir notamment :
« Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
2. Considérant que, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de conclusions tendant à ce que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d’urgence ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. M. et M. G. se sont installés avec leurs véhicules et caravanes sans droit ni titre sur l’aire d’accueil Les Mollaires sise à Saint-Florent-des-Bois laquelle est gérée par La-Roche-sur-Yon agglomération ; que des arrêtés leur ordonnant de quitter les lieux sans délai ont été pris par le président de cet établissement public le 10 avril 2015 ; que la demande de la collectivité ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que l’évacuation des intéressés revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que des dégradations des équipements ont été constatés le 31 mars 2015 outre un départ de feux dans le local poubelles et l’incendie d’un véhicule volé sur un terrain vague situé à proximité de l’aire d’accueil ;
4. Considérant par suite, qu’il y a lieu, d’enjoindre aux intéressés et à tous les occupants de leur chef, de libérer sans délai les lieux et de dire, qu’à défaut de ce faire, la communauté d’agglomération X pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par personne et par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la présente ordonnance ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de M. M.et de M. G. la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération X en raison de la présente instance et non compris dans les dépens ; » (TA Ordonnance de référé du 29 avril 2015, n°1503269)
Jérôme MAUDET
Avocat au barreau de NANTES
Droit de propriété : peut ont faire supprimer une servitude de vue ou un simple jour ?
L’article 676 du Code civil relatif aux jours précise que :
« Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. »
L’ouverture de jours respectant les dispositions des articles 676 et 677 du Code civil correspond à l’exercice normal du droit de propriété et n’implique aucune prétention de servitude sur le fonds voisin.
L’ouverture d’une fenêtre qui est un simple jour et non pas une vue droite ne peut pas entraîner l’acquisition par prescription d’une servitude de vue.
Le propriétaire du « fonds servant » ne peut, en principe, pas en demander la suppression.
Rien ne lui empêche, en revanche, de bâtir un mur, même à l’extrême limite de votre fonds, en respectant la réglementation et ainsi obstruer les jours ouverts sur son fonds.
S’il s’agit en réalité d’une vue au sens de la jurisprudence, la question est un peu plus délicate.
S’agissant des servitudes de vue, l’article 688 du Code civil dispose en effet que :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. »
L’article 689 dispose pour sa part que :
« Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. »
L’article 690 précise enfin que :
« Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
S’il n’existe aucune mention dans les titres et que la vue existe depuis moins de 30 ans, la suppression de la vue peut être exigée.
En effet la jurisprudence considère de manière constante, y compris lorsqu’il existe un acte sous-seing privé, (c’est-à-dire une convention prévoyant la création d’une servitude au profit d’une personne et non d’un fonds) qu’une servitude doit être reprise par acte authentique :
« Constitue une condition intrinsèque de validité de la servitude de vue la reprise par acte authentique, pour inscription au livre foncier, de l’acte sous seing privé autorisant la création de vues droites.
La mention de l’acceptation des servitudes existantes dans l’acte de vente d’un immeuble ne saurait régulariser la servitude de vue litigieuse, celle-ci doit donc être supprimée. » (Cour d’appel, COLMAR, Chambre civile 3, 5 Novembre 1990, Numéro JurisData : 1990- 050314)
En l’absence de mention de la servitude dans le titre, l’action du propriétaire du « fonds dominant » ou des éventuels acquéreurs destinée à obtenir le maintien du jour serait difficile à mettre en œuvre.
« L’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. Il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l’insuffisance de l’acte invoqué comme titre de servitude lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. » (CAA Lyon, 15 octobre 2013, N°12/02660).
Jérôme MAUDET
Avocat
Droit de la construction : L’intérêt du référé préventif en droit administratif
A l’occasion de travaux publics, il peut être intéressant pour une commune ou l’un de ses mandataires, de faire établir un constat des propriétés avoisinantes afin de prévenir toute contestation ultérieure.
Un constat d’huissier est envisageable ainsi qu’une expertise amiable réalisée par un homme de l’art.
Toutefois, ces deux méthodes sont loin de pouvoir rivaliser avec une expertise judiciaire contradictoire.
En effet, une telle expertise sera opposable aux parties à la cause et la mission confiée à l’homme de l’art pourra se poursuivre pendant toute la durée des travaux.
En outre, en cas de difficulté de quelque nature que ce soit, il pourra en être référé au juge en charge du contrôle des expertise.
Dans le cadre de travaux publics, la compétence juridictionnelle pour désigner un expert aux fins de constat préventif appartient au juge adminsitratif.
Le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction.
L’article R. 532-1 du Code de justice administrative dispose en effet que :
« Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. »
La mission de l’expert proposée au Tribunal dépend de différents paramètres et notamment de la configuration des lieux et des protagonistes (copropriété, centre ville, campagne….)
L’objectif est de faire dresser un état descriptif et qualitatif des immeubles riverains.
Ainsi, si des fissures apparaissent sur lesdits immeubles en cours de chantier, la collectivité devra prendre en charge les frais de réparation ou les faire supporter aux entreprises ou à son assureur.
Inversement les fissures préexistantes ne pourront donner lieu à aucune demande de la part des riverains.
Il est également intéressant de solliciter du juge des référés que l’expert puisse s’adjoindre les conseils d’un sapiteur dans des cas précis (risque de pollution voire d’effondrement, milieu sensible….).
Dans le cadre d’une telle procédure les collectivités ont souvent intérêt à rendre opposables les opérations d’expertise aux entreprises en charge des travaux.
Du point de vue de la procédure, et à l’inverse de la procédure judiciaire, c’est le greffe du Tribunal qui se charge de la notification des requêtes aux défendeurs et non un huissier.
Le coût pour la collectivité s’avère donc moins important que dans le cadre d’une procédure initiée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aucune consignation ne sera exigée avant le début des opérations d’expertise.
Le montant des frais d’expertise sera fixé par ordonnance de taxe qui intervient après le début des opérations d’expertise, voire même après le dépôt du rapport.
En règle générale, il convient de prévoir un délai d’environ un mois entre le dépôt de la requête et la désignation d’un expert judiciaire.
Jérôme MAUDET
Avocat au Barreau de NANTES